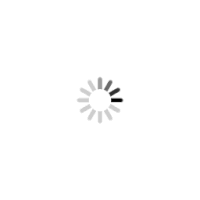

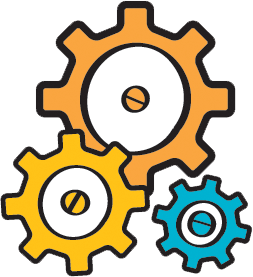


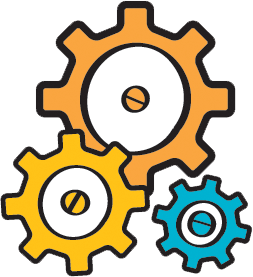


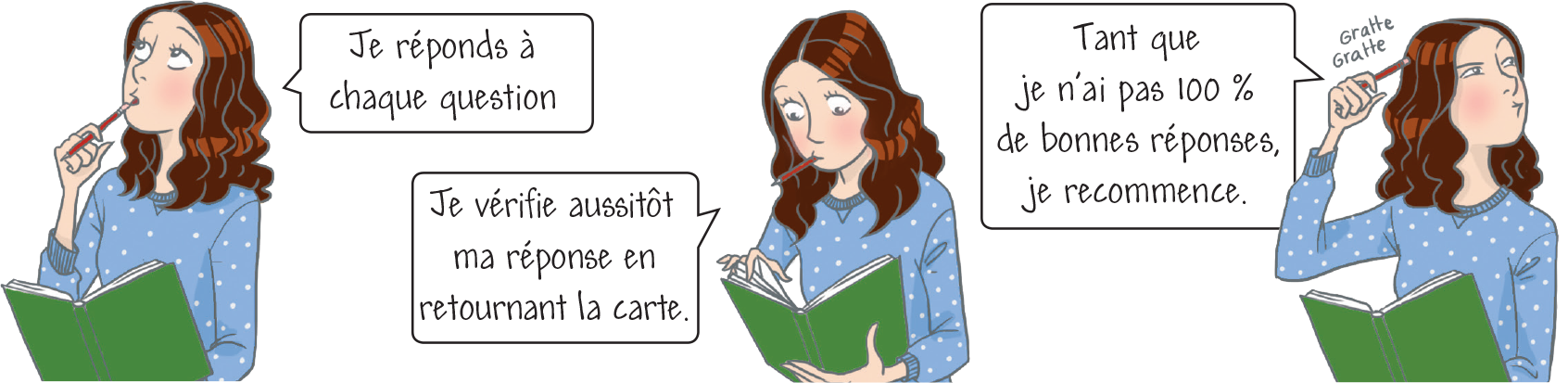
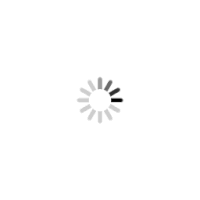

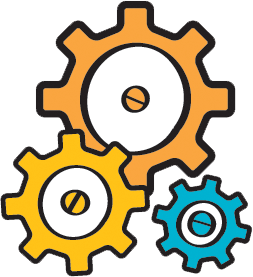


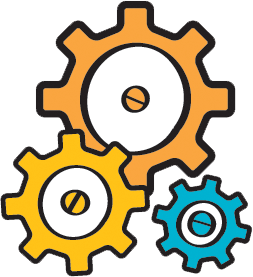
Correction cartes lycée
|
Définir la concentration en masse d'un soluté en solution. > Fiche 46 |
La concentration en masse Cm de soluté dans une solution est la masse de soluté dissous par litre de cette solution : Cm = |
|
Qu’est-ce qu’une dilution ? > Fiche 46 |
Diluer une solution mère consiste à ajouter du solvant pour préparer une solution fille moins concentrée. |
|
Qu’est-ce qui se conserve lors d’une dilution ? > Fiche 46 |
Lors d’une dilution, la masse de soluté dissous se conserve. |
|
Donner la relation permettant de calculer la masse d’un atome. > Fiche 47 |
La masse d’un atome est pratiquement égale à celle de son noyau, qui contient A nucléons : matome = A × mn avec mn, la masse d’un nucléon. |
|
Qu’appelle-t-on électrons de valence d’un atome ? > Fiche 47 |
Les électrons de valence d’un atome sont les électrons de la dernière couche remplie. |
|
Quel lien existe-t-il entre la position d’un élément dans le tableau périodique et la configuration électronique de l’atome associé ? > Fiche 47 |
Pour les trois premières lignes : le numéro de la période est égal au nombre de couches électroniques contenant des électrons. Le numéro de la colonne est lié au nombre d’électrons de valence de l’atome. |
|
Quand dit-on qu’une entité chimique est stable ? > Fiche 48 |
Une entité chimique est stable si sa couche de valence est saturée. |
|
Qu’appelle-t-on doublets liants ? doublets non liants ? > Fiche 48 |
Un doublet liant forme une liaison entre deux atomes : il est formé de deux électrons appartenant à deux atomes différents. Un doublet non liant est formé de deux électrons appartement au même atome (électrons de sa couche de valence). |
|
Qu’est-ce qu’une mole ? > Fiche 49 |
Une mole d’entités chimiques contient 6,02 × 1023 entités chimiques identiques. |
|
Donner la relation entre la quantité de matière et le nombre d’entités chimiques dans un échantillon. > Fiche 49 |
La quantité de matière n d’un échantillon est liée au nombre N d’entités chimiques par la relation : N = 6,02 × 1023 × n |
|
Quelle différence existe-t-il entre une transformation nucléaire et une transformation chimique ? > Fiche 50 |
Lors d’une transformation nucléaire, les éléments chimiques ne sont pas conservés. Lors d’une transformation chimique, les éléments chimiques sont conservés. |
|
Qu’est-ce que la fusion ? > Fiche 50 |
Lors d’une fusion, deux noyaux légers s’assemblent pour former un noyau plus lourd. |
|
Qu’est-ce que la fission ? > Fiche 50 |
Lors d’une fission, un noyau lourd est fragmenté en noyaux plus légers. |
|
Quelles sont les lois à respecter pour ajuster l’équation d’une réaction chimique ? > Fiche 51 |
Pour ajuster l’équation d’une réaction chimique, il faut respecter : |
|
Qu’est-ce qu’un réactif limitant ? > Fiche 51 |
Le réactif limitant d’une transformation chimique est le réactif totalement consommé en premier. |
|
Comment déterminer le réactif limitant d’une réaction d’équation : > Fiche 51 |
Le réactif limitant est le réactif pour lequel le rapport de sa quantité de matière initiale sur son nombre stœchiométrique est le plus petit. |
|
Énoncer le principe d’inertie et sa contraposée. > Fiche 52 |
Un système est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme si les forces extérieures qui s’exercent sur ce système se compensent et réciproquement. Si les forces extérieures qui s’exercent sur un système ne se compensent pas, ce système n’est ni immobile ni en mouvement rectiligne uniforme et réciproquement. |
|
Énoncer le principe des actions réciproques. > Fiche 52 |
Si un système A exerce sur un système B une force
|
|
Qu’est-ce qu’un spectre ? > Fiche 53 |
Un spectre est la figure obtenue par dispersion de la lumière, par un prisme ou un réseau, en radiations colorées. |
|
Décrire le spectre d’émission d’un corps chaud et celui d’un élément chimique. > Fiche 53 |
Le spectre d'émission d’un corps chaud est continu alors que le spectre d’émission d’un élément chimique est un spectre de raies (discontinu). |
|
Nommer les trois points caractéristiques d’une lentille mince convergente. > Fiche 54 |
Les trois points caractéristiques d’une lentille mince convergente sont son centre optique, son foyer objet et son foyer image. |
|
Donner les propriétés des trois rayons lumineux permettant de tracer l’image d’un objet par une lentille mince convergente. > Fiche 54 |
Un rayon qui passe par le centre optique n’est pas dévié. Un rayon qui passe par le foyer objet émerge de la lentille parallèlement à l’axe optique. Un rayon qui arrive parallèlement à l’axe optique passe par le foyer image. |
|
Donner la relation permettant de calculer le grandissement d’une lentille mince convergente. > Fiche 54 |
Le grandissement est le rapport entre la taille de l’image A’B’ et la taille de l’objet AB : γ = |
|
Donner la relation entre la période et la fréquence d’un signal sonore périodique. > Fiche 55 |
La période T (en s) et la fréquence f (en Hz) d’un signal sonore périodique sont liées par la relation : f = |
|
À quelle grandeur physique la hauteur d’un son est-elle reliée ? > Fiche 55 |
La hauteur d’un son est liée à sa fréquence. |
|
Quelles caractéristiques d’un son permettent de différencier deux instruments qui l’émettent ? > Fiche 55 |
Le timbre et l’intensité sonore d’un son permettent de distinguer deux instruments qui l’émettent. |
|
Qu’appelle-t-on point de fonctionnement d’un dipôle ? > Fiche 56 |
Le point de fonctionnement d’un dipôle est le point d’intersection entre la caractéristique de ce dipôle et la caractéristique du générateur auquel il est branché (branchement du dipôle en série aux bornes du générateur). |
|
Qu’est-ce qu’un capteur résistif ? > Fiche 56 |
Un capteur résistif est un capteur qui restitue une résistance en sortie. |
|
Que représente la courbe d’étalonnage d’un capteur résistif ? > Fiche 56 |
La courbe d’étalonnage d’un capteur résistif représente l’évolution de sa résistance en fonction de la grandeur physique d’entrée. |